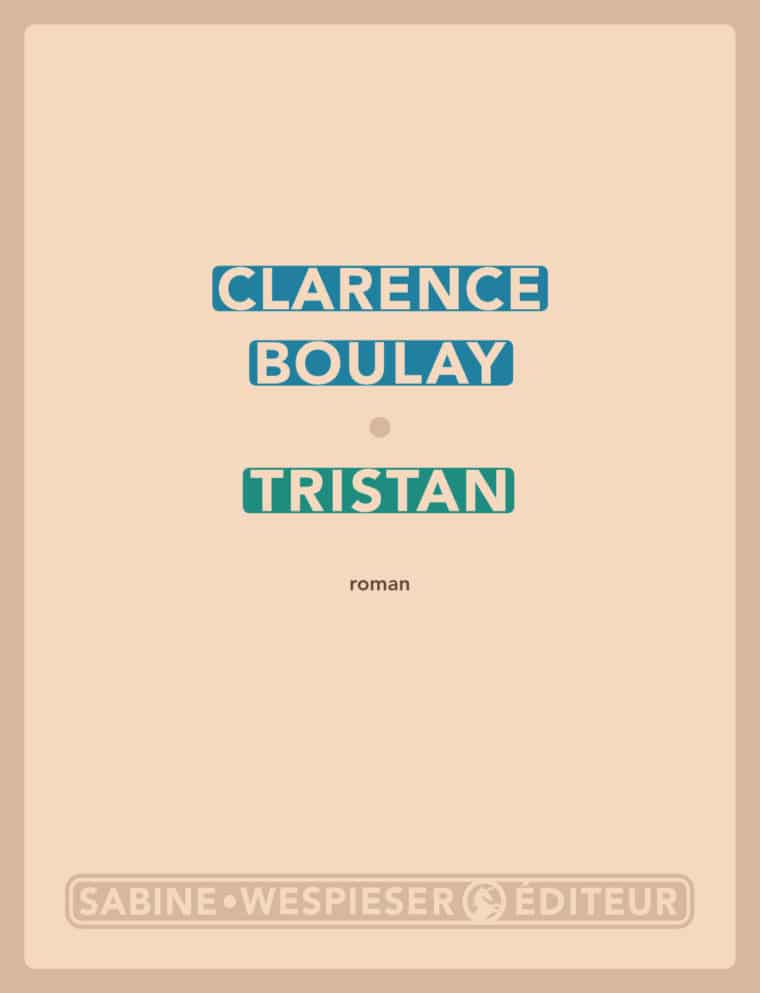
- Livre : Tristan
- Auteur : Clarence BOULAY
- Article complet
- Revue de presse
LE MONDE DES LIVRES, Leïla Slimani, vendredi 12 janvier 2018
« Les jeunes gens et la mer »
« L’aventure est-elle encore possible ? Dans un monde fini, mesuré, infiniment exploré, on éprouve parfois de la nostalgie pour l’inconnu et les grandes découvertes. À l’époque du tourisme de masse, de la démesure démographique, reste-t-il une place pour la solitude et l’émerveillement ? Dans Tristan, très beau roman de Clarence Boulay, on embarque pour un voyage au bout du monde. Ida quitte Le Cap, en Afrique du Sud, à bord d’un langoustier, pour rejoindre l’île de Tristan. Un minuscule morceau de terre, à quelques encablures de Sainte-Hélène. Elle débarque sur ces terres sauvages où vit une petite communauté qui garde avec les étrangers des relations à la fois distantes et cordiales. Ida trompe sa solitude en dessinant sur son bloc les lignes épurées de la mer et des côtes.
Lorsqu’une épave échoue sur l’île aux Oiseaux toute proche, elle se porte volontaire auprès d’un équipage restreint et uniquement masculin pour aller évaluer les dégâts. Les quelques jours passés sur le rocher sont éprouvants. Il faut chasser et pêcher pour se nourrir. Dormir à même le plancher en prenant garde aux skuas, des oiseaux qui risquent de vous « bouffer les yeux ». Avec un naturel incroyable, Clarence Boulay entremêle alors le récit de ce combat avec les éléments et celui de la naissance d’une passion physique et amoureuse avec Saul.
Ce texte ne ressemble à aucun autre. On n’y trouvera ni les codes du récit d’aventure ni ceux du journal de bord purement impressionniste. Il y a l’océan, les tempêtes et des animaux sauvages, mais pas de volonté de singer Melville ou Conrad. La langue, d’abord, est tout à fait singulière, vaporeuse et précise, suprêmement sensuelle. Il y a de la vie dans ce récit, de la chair, des peaux et des entrailles. Ida regarde avec passion son amant dont elle exalte la force, l’abandon, la beauté. Dans une scène magnifique, elle raconte la façon dont elle apprend à éventrer des pétrels, de petits oiseaux dont elle vide les entrailles et extrait la graisse pour en faire de l’huile. On croirait alors sentir la matière sur nos doigts.
Ida, la narratrice, parle à la première personne, mais garde un quant-à-soi qui confère au texte son mystère et son élégance. Clarence Boulay est tout entière au présent. Elle écrit comme elle dessine sur son bloc-notes, sans calcul. « Je déteste les romans », confie-t-elle d’ailleurs au détour d’une page. Et c’est pour cela que sa passion amoureuse et sensuelle pour Saul et pour ce paysage est si grande. Parce qu’elle oublie qu’il y a un arrière-plan, d’autres gens, d’autres temporalités. « À aucun moment Saul ne m’avait décrit sa femme ; je ne l’avais d’ailleurs, moi-même, jamais imaginée. »
Ida n’est pas une Juliette du bout du monde et elle sait qu’on ne peut jamais posséder son Roméo. De la même manière, elle semble penser que tout récit de voyage est à la fois ridicule et dérisoire. « Alors, n’est-ce pas incroyable ce que vous vivez ? Six mois, m’a-t-on dit, que vous habitez ici sur cette île isolée (…). C’est extraordinaire ! », lui dit un homme. Un commentaire bien vain pour celle qui semble croire que l’expérience de l’ailleurs est indicible. Ça ne se contient pas dans le nombre de photos qu’on a prises, dans les panoramas spectaculaires que l’on a observés, dans les dessins qu’on a griffonnés. Tout cela ne fait qu’effleurer l’essentiel : les odeurs, le plaisir, le contact d’une peau. »