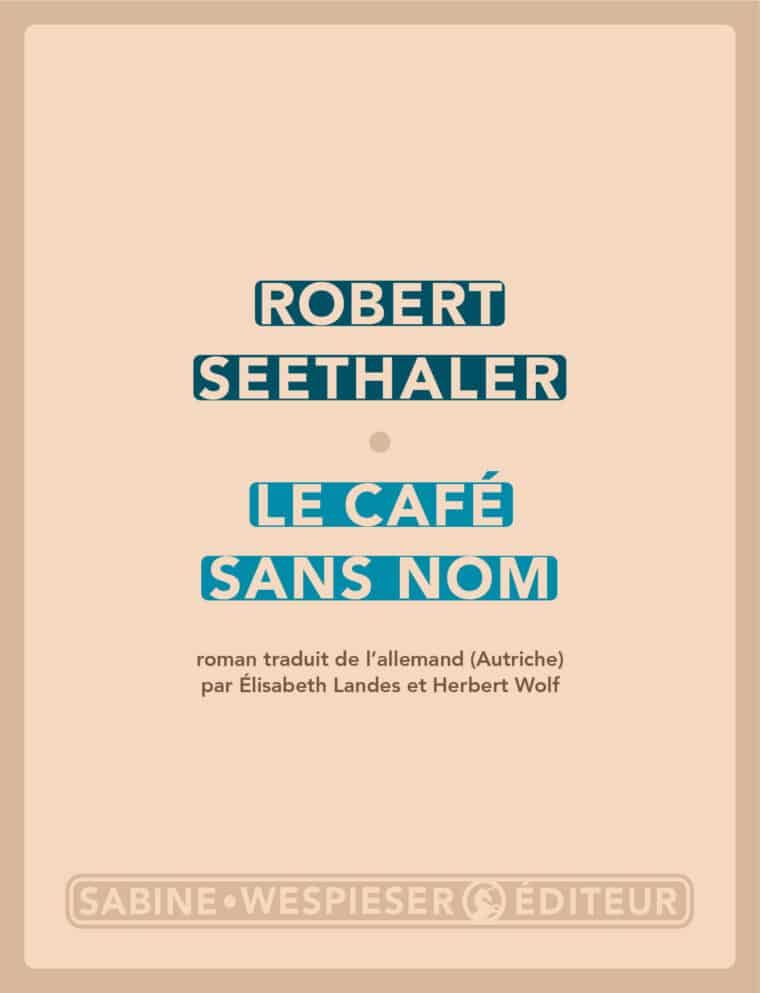
- Livre : Le Café sans nom
- Auteur : Robert SEETHALER
- Revue de presse
Encres vagabondes, février 2024
Lire l’article sur le site Encres vagabondes
Dans un faubourg populaire de Vienne non loin du Prater et de sa célèbre Grande Roue, en cet été 1966, Robert Simon travaille comme journalier au marché des Carmélites et loge chez Martha Pohl qui lui loue une chambre et lui prépare ses repas. « Il aidait déjà depuis un bout de temps au marché, ce qui lui permettait de poser parfois sur la table de la cuisine quelques pommes de terre pour la soupe, un céleri-branche, un morceau de foie ou même un paquet de hachis de porc. Il gagnait assez pour son entretien, et cette vie lui convenait, il se serait bien vu, quant à lui, continuer un bon moment comme ça. » Celui que l’auteur désigne le plus souvent par son seul patronyme aime aussi après sa journée de travail à s’attabler au soleil sur la terrasse du peu reluisant café de la grand-place pour regarder les commerçants laisser place nette à la fin du marché.
La fermeture de ce café devant lequel le trentenaire passait chaque matin, son endormissement et sa dégradation au fil des jours peinaient celui qui louait ses bras à tous les commerçants du marché comme manutentionnaire et cela réveilla son vieux rêve de devenir son propre patron en redonnant vie au vieux café pour y accueillir tous les habitants du quartier. « Il se disait que ce ne serait pas bien sorcier d’y attirer les gens chaque jour » et comme lui avait répondu la veuve de guerre qui, quand Simon était sorti de l’orphelinat, avait accepté de lui louer une chambre lui permettant ainsi de vivre et travailler dans le quartier où il était né : « Il faut toujours que l’espoir l’emporte un peu sur le souci. Le contraire serait vraiment idiot, non ? » L’aventure est risquée pour quelqu’un dont les économies sont maigres et qui manque d’expérience en la matière mais après une longue réflexion, l’accumulation d’un modeste pécule lui permettant de survivre sans salaire le temps des travaux et encouragé par l’effervescence qui s’emparait de la ville en pleine reconstruction vingt ans après la fin de la guerre, Simon décide de sauter le pas. C’est le cœur battant qu’il se rend un matin sur la Haidgasse pour rencontrer Kostya Vavrovsky, le propriétaire de l’immeuble où se trouve le café abandonné. Devant l’opportunité d’un bail lui offrant une rentrée mensuelle inespérée pour un bien dégradé et invendable l‘homme d’affaires ne se fait pas prier.
Dans les délais prévus, grâce à l’investissement personnel et physique sans faille du gérant, le café qui a fait peau neuve est inauguré par une grande fête avant d’ouvrir comme prévu le lendemain à midi tapant et d’y accueillir son premier client dix minutes plus tard. Ce café sans nom (Simon trouvant prétentieux de lui donner son nom et son ami boucher lui assurant que « Tout compte fait, le Danube existait avant que quelqu’un l’appelle Danube ») se fait lentement une clientèle d’habitués, des vieux du quartiers qui s’y retrouvent pour jouer aux cartes, des commerçants du marché, des ouvriers de l’équipe du matin, des employés en bras de chemise et les filles de l’usine de fil. Du vieux café sombre il a fait un lieu modeste mais accueillant où le client est toujours le bienvenu, où il fait bon s’attarder devant un verre ou un café, manger une grande tartine de saindoux avec ou sans cornichons (seul aliment solide proposé sur place), « parler quand on en a besoin et se taire quand on en a envie » et partager un peu de chaleur humaine. Tout alla bien jusqu’à l’apparition de l’hiver, la neige et le froid. Simon s’angoisse et craint de devoir mettre la clé sous la porte quand sa précieuse logeuse lui souffle qu’« un hiver sans punch n’est pas un hiver digne de ce nom. » La recette de la veuve sera très appréciée par la clientèle et les affaires de Simon redémarreront au-delà de ses espérances. « Il avait chassé les vieux fantômes et ouvert la porte à quelque chose de neuf, une force insoupçonnée l’avait envahi et, depuis lors, jamais quitté. » Mais le patron qui consacre tout son temps sept jours par semaine à son café, victime de son succès s’épuise. C’est alors que Mila, une jeune ouvrière licenciée par son usine de confection il y a trois mois et ne parvenant pas depuis à retrouver un travail pour se nourrir et payer son loyer fait un malaise devant la boucherie de Johannes Berg. Celui-ci ne sachant que faire là, en face du café, demande à son ami d’apporter un remontant et des cornichons à la jeune femme qui reprend vite conscience. Le brave boucher ému par l’histoire de la jeune femme en profite aussi pour souffler à l’oreille de Simon qu’il faut peut-être y voir un signe du hasard. Mila ne serait-elle la bonne personne pour l’aider au café ? Réticent et inquiet de se mettre sur le dos un salaire, Simon finit quand même par céder à la pression de Johannes et propose de faire un essai. Courageuse, efficace, solide et appréciée par la clientèle, Mila parviendra vite à le convaincre de la garder à son service. Quelques mois plus tard, sa trésorerie lui permettra de fermer le café le mardi pour qu’ils aient tous deux un jour de repos par semaine. Cela lui permettra de renouer avec les grandes marches dont il était auparavant adepte pour entretenir sa condition physique et se ressourcer.
Au Café sans nom, le temps passe au fil des peines et des joies de la petite communauté d’habitués, les amours s’y nouent ou s’y dénouent, des éclats de violence vite pondérés par Simon y éclatent parfois et, au rythme des saisons « une sorte de personnalité́ et, au dire de Mila, quelque chose comme une âme » se dessine. Pendant ce temps, à quelques pas de là, Vienne de l’après-guerre n’en finit pas de se transformer et se moderniser. C’est alors que des spéculateur immobiliers s’intéressent de près à ce vieux quartier périphérique qui pourrait bien être sa prochaine cible sans que les habitants n’en aient pris conscience. La dynamique amorcée avec le Café sans nom n’empêchera pas l’esprit du vieux quartier de s’éteindre doucement et le couperet de la fermeture de tomber brutalement. Kostya Vavrovsky, piètre gestionnaire des biens légués par ses parents dont ce café et étranglé par les dettes, s’est vu contraint de liquider tout ce qu’il possédait et donc de rompre le bail qui les unissait. C’est par un courrier officiel que Simon apprendra son expulsion prochaine. Pour faire écho à l’inauguration du Café sans nom plus de dix ans auparavant, Simon décide alors de fermer la boucle par une grande fête de remerciement à ses fidèles habitués. « Ces dernières années, le quartier du marché des Carmélites s’était transformé petit à petit, même si, prises isolément, ces transformations ne lui avaient pas semblé si importantes et, a posteriori, la fête lui apparut comme les derniers feux d’un temps quasiment révolu, les dernières braises dont les lueurs claires perçaient encore le brouillard du passé. » Il lui restait quelques semaines avant de fermer définitivement la porte derrière lui et certains, par solidarité ou par peur de la solitude qui les attendait, en profitèrent jusqu’au tout dernier jour. « À sa grande surprise, il n’éprouvait aucune tristesse. Peut-être était-il tout simplement trop exténué pour être triste. » « C’est très bien comme ça, se disait-il, il faut mettre un terme aux choses tant qu’on a la force de commencer quelque chose de nouveau. » « Des temps meilleurs, c’étaient aussi des temps nouveaux, il fallait d’abord s’habituer. »