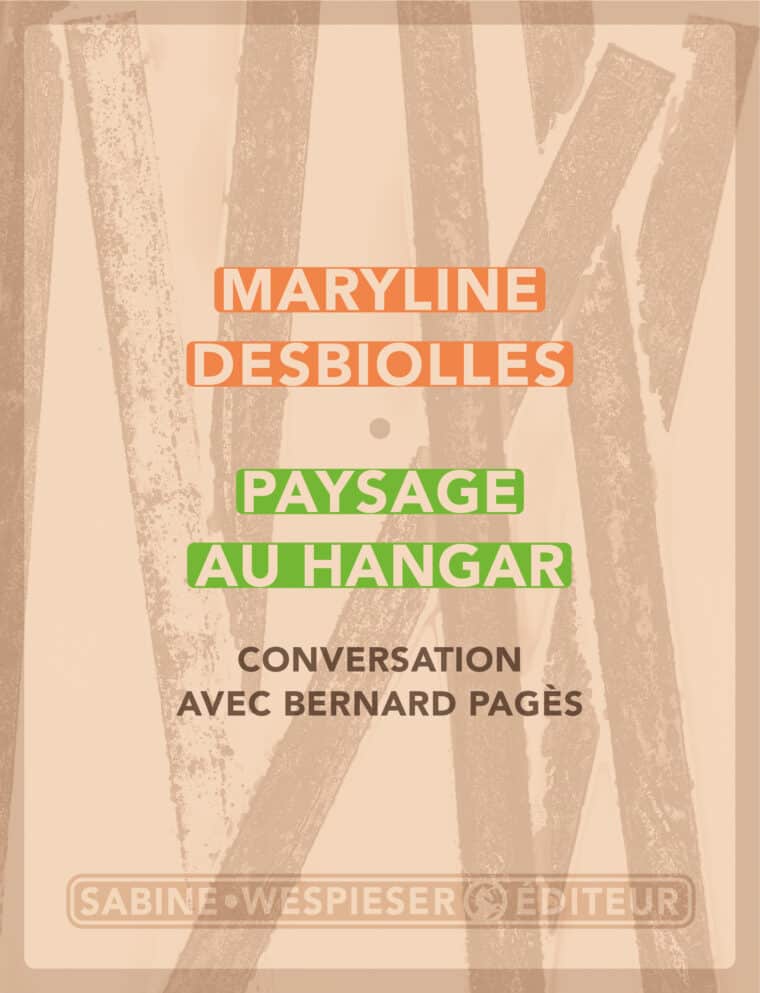
- Livre : Paysage au hangar
- Auteur : Maryline DESBIOLLES
- Revue de presse
Étude de Pierre Campion, mercredi 13 mars 2024
Maryline Desbiolles publie une œuvre importante. Avec Anchise (1999), elle a obtenu le prix Femina. Depuis, se sont succédé, entre autres livres, Primo (2005), Les Draps du peintre (2008), Une femme drôle (2010), La Scène (2010), Dans la route (2012), Vallotton est inadmissible (2013), Rupture (2018), Machin (2019), Le Neveu d’Anchise (2021), Charbons ardents (2022), Il n’y aura pas de sang versé (2023).
Entre 1990 et 1993, elle a dirigé la revue La Mètis, dont plusieurs articles ont été repris sur ce site, avec son accord.
Un nouveau personnage de la romancière
Bernard Pagès est un artiste connu. D’abord peintre puis sculpteur, il a construit une œuvre dont il envisage encore des développements. Maryline Desbiolles lui passe la parole. Il l’accepte, il consent à être un personnage de la romancière, mais pas forcément docile à ses questions.
À chaque livre de Maryline Desbiolles, on se demande comment elle fera le suivant, comment elle inventera le futur de son œuvre.
Eh bien, voici une conversation, une suite d’entretiens entre la romancière Maryline Desbiolles et l’artiste Bernard Pagès. Conversation singulière, non pas en son principe car les artistes aiment à échanger avec des écrivains, et réciproquement. Ce qui frappe, même si le propos du peintre fait la plus grande partie du livre et que le titre annonce un paysage de peinture, c’est que ce livre est publié sous le seul nom de la romancière.
Dans son œuvre, il y avait déjà un peintre, Félix Vallotton, Vallotton est inadmissible (Seuil, 2013), et même une sorte de fantaisie, Manger avec Piero (Mercure de France, 2004), qui raconte une recette de cuisine amoureuse sous le patronage du grand fresquiste italien.
Cherchons encore un peu, et nous trouvons l’évocation d’un peintre dans un roman de Maryline Desbiolles, Les Draps du peintre, Seuil, 2008. De son peintre de fiction, elle écrit : « Rien ne le destinait à être peintre. Et ce rien dont il sort, ce brouillard est peut-être ce qui lui a défendu de jamais s’établir, de jamais composer avec le monde que la peinture aurait dû révolutionner, comme il l’a cru un temps. Romanichel avant toute chose : celui qui l’attrapera n’est pas né. Plutôt que le retenir, tenter un pas de danse, inédit, avec lui. »
On a identifié le peintre de ce roman comme étant Pincemin, un ami de Pagès. Mais la description pourrait convenir aussi à Pagès. Ce peintre-là, peut-être était-ce déjà lui.
Un nouveau pas de danse avec un artiste
Elle : Veux-tu être mon cavalier ? Lui : Oui, mais libre cavalier. Et, par exemple, quand tu me demanderas, question chère à ton style d’écriture et de vie, s’il n’y a pas, dans mon austérité de vie et d’artiste, quelque morale ou quelque politique, je te répondrai un peu à côté : « Peut-être. Mais j’ai froid, ça devine la pluie. Je vais fermer la porte. C’est déjà l’automne. […] Ce qui compte pour moi, c’est le plein air, la lumière naturelle, c’est un atelier, un appentis ouvert sur l’extérieur, un terrain sur lequel on s’agite. J’ai gardé ce goût de mes années d’enfance, ces sept premières années à la ferme, essentiellement des images d’extérieur, une succession d’images lumineuses » (p. 130-132). C’est comme ça, c’est un fait, hasardeux, je suis né à tel moment, dans un non-lieu du monde.
Voilà donc que Maryline Desbiolles cède la parole à un plasticien, comme on dit, et que celui-ci accepte avec plaisir de se faire un personnage de la romancière.
Discrètement, celle-ci rédige les notes de bas de page pour éclairer les allusions de l’artiste. Surtout, elle conduit la conversation avec Bernard Pagès, en vingt journées, réparties entre le 6 octobre 2020 et le 7 janvier 2022 sur une durée réelle d’un an et cinq mois. Tel est le temps qu’ils se sont donné pour ordonner les moments et péripéties d’une aventure commune, à la recherche du sens d’une œuvre.
Duo de paroles, l’une relançant l’autre, une sorte d’oratorio dont l’intrigue consiste dans la découverte d’une vérité, celle d’une vie de l’artiste et des secrets de cette vie — secrets de métier, secrets d’existence. Petits métiers et domiciles à l’avenant, rencontres entre artistes et ruptures, méconnaissance et reconnaissance, passage de la peinture à la sculpture et émancipation, impasses et dépassements, « la vie d’artiste » quoi…
Céder la parole à l’artiste
Pour une romancière comme Maryline Desbiolles qui pratique pour son propre compte une écriture du parler, c’est le signe d’une confiance dans son interlocuteur, dans sa verve, c’est-à-dire dans la capacité de cette parole à décrire un monde muet. Une gageure, faire parler un artiste de son art.
Au fondement de cette confiance, il y a une sorte de fascination de la romancière pour ce qu’il détient lui et elle non, du fait de la différence d’âge entre elle et lui : elle le fait commencer par ses souvenirs de l’Occupation allemande. Dans un paysage vide et hanté de rares vieillards, isolé d’avance par son site et privé du peu de circulation qui s’y faisait déjà auparavant, un pays à la route blanche — de ces routes où marchaient Rimbaud et Verlaine soixante-dix ans auparavant, non goudronnées, des grands chemins empierrés et poudrés de poussières que lavent les pluies. Un paysage dans lequel se dissimulent des maquisards fantomatiques, peu héroïques, qui font peur aux parents et intriguent les enfants. On n’y verra pas des défilés de la Libération.
Un pays d’où reviennent au peintre des expressions de l’occitan, cette langue du Midi qui peut rappeler à la romancière l’italien dialectal de ses propres aïeuls, habitants d’Uriage la ville savoyarde de l’aluminium et de Turin capitale du royaume de la Savoie, de Primo un jeune oncle disparu et de sa grand-mère (Primo, roman, Seuil, 2005).
Un paysage hanté par la figure d’un petit hangar ouvert aux vents et protecteur pourtant, un motif qui reviendra sans cesse dans le propos du peintre, dans un tableau même et, en vrai et en grand, dans l’installation finale à La Fontaine de Jarrier, dans l’arrière-pays de Nice.
« L’ailleurs, la peinture »
Desbiolles : Est-ce que tu peux dater le moment où tu as commencé à peindre, où, pour le dire pompeusement, la peinture est entrée dans ta vie ?
Pagès : La peinture n’est pas entrée dans ma vie, c’est un pays dans lequel je suis entré, par la force des choses.
Un déménagement, et voilà la famille Pagès à Laroque. Une grande maison que le père fait rajeunir par Segundo, un peintre en bâtiment espagnol exilé de son pays :
« Avec trois fois rien, de la couleur en poudre, de l’eau et de la colle pour les murs, deux bouteilles d’huile de lin pour les boiseries, il a métamorphosé la maison. Magique ! […] Le regarder faire si bien avec si peu a été très instructif pour moi. » (p. 34)
Elle entend Segundo et elle pense à Primo, mais elle ne s’y arrête pas.
À l’école du village, grâce à une institutrice, premiers dessins, punaisés un peu partout dans la maison. Aux grandes vacances du lycée, la peinture « comme une libération extraordinaire. Car j’étais presque toujours puni, consigné au lycée dont je ne pouvais pas sortir. C’était effrayant ». Au gré des circonstances, la peinture sera toujours l’extérieur de la vie, et le refuge de la vie.
Des rencontres et voilà que l’on est devenu peintre (mais pas comme les barbouilleurs du moment), une visite de l’atelier de Brancusi et voilà que l’on devient sculpteur (mais pas comme Brancusi).
Mettre de l’air et des passages entre les choses.
La sculpture sera la vraie patrie de Bernard Pagès, son « vrai lieu » (Bonnefoy), sa « vraie vie » (Proust). Mais non sans nostalgie de la peinture. Une sculpture quelque peu sauvage, d’arrangements et d’assemblages de déchets glanés dans les décharges (il n’y en a plus) puis de pièces de métal trouvées dans les casses d’autos et de machines agricoles.
Et toujours ce temps de passé, de présent et d’avenir :
« Mes sculptures sont fragiles de toute manière. Elles sont fabriquées de nombreux éléments disparates, ce qui les fragilise. Ça me tracasse. J’essaie de ne pas y penser. Je connais les faiblesses de chacune, si je m’écoutais, j’en referais certaines, entièrement, mais je ne peux pas passer mon temps à réparer des sculptures anciennes, j’ai encore des trucs à faire. » (p. 155)