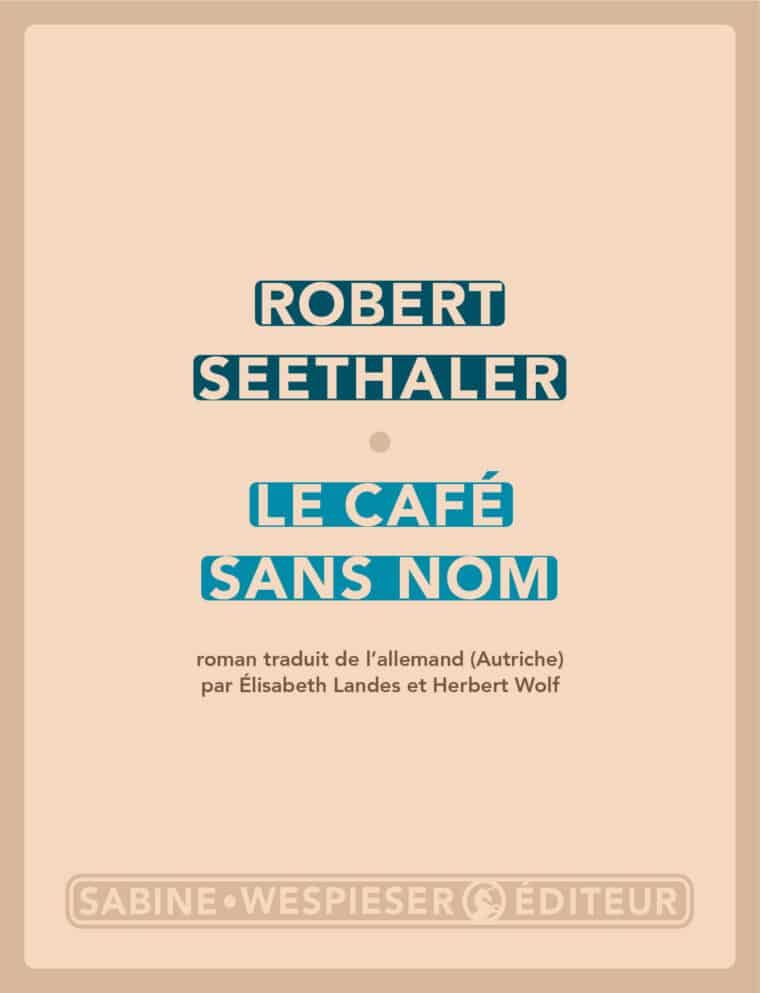
- Livre : Le Café sans nom
- Auteur : Robert SEETHALER
- Revue de presse
RTBF, Musiq3, « La Matinale », Sophie Creuz, jeudi 14 septembre 2023
Écouter la chronique de Sophie Creuz
Ce n’est pas au Café Zimmerman que Sophie Creuz vous invite, l’établissement célèbre de Leipzig, où Bach et Telemann, dit-on, jouaient leurs œuvres. Cap sur la ville de Vienne, où d’autres cafés célèbres, véritables institutions culturelles, ont abrité les cerveaux bouillonnants de Mozart, Beethoven et plus tard de Freud, Klimt, Kokoschka, Arthur Schnitzler ou Stefan Zweig.
Mais dans ce roman, si nous sommes bien à Vienne, nous nous asseyons avec quelques habitués anonymes à l’une des petites tables au vernis rayé du « Café sans nom ». Cet établissement, qui ne paie pas de mine, a été repris par Robert Simon, anciennement homme à tout faire au marché des fruits et légumes. Il en rêvait.
Nous sommes à la fin des années 60 et Vienne garde encore les stigmates des bombardements des Alliés, surtout dans ce quartier populaire près de la Leopoldstrasse, du Prater et du vieux Danube. Et déjà, des bourgmestres entendent effacer tout cela, rebâtir une ville moderne, sans petits vieux, sans invalides de guerre, sans chômeurs, sans lieux accueillants où poser sa solitude.
Tout ce qu’il est possible de faire au « Café sans nom », où les commères peuvent cancaner en se remettant du rouge à lèvres, où les anciens catcheurs peuvent trouver l’amour, et où les taiseux peuvent se taire pendant des heures devant un soda-framboise sans que personne ne les chasse.
Au « Café sans nom », pas de garçon en gilet noir qui vous sert un moka sur un plateau d’argent, pas non plus de Wiener schnitzel bien garni mais une tartine de saindoux avec des jeunes oignons ou des cornichons au sel. Et cela suffit au bonheur.
C’est le talent de ce magnifique écrivain, Robert Seethaler, – dont toute l’œuvre est publiée en français par Sabine Wespieser – que de raconter en quelques pages, les vies qui trottinent, les êtres qui glissent le long des murs, les mutiques qui, sans la ramener, ont vécu Dieu sait quel drame, égarement, voire, forfaiture ou exploit.
« Ils étaient tous si beaux » dira le cafetier, avec une économie de mots à l’égal de ses moyens à lui. Une parcimonie à laquelle colle l’écriture de Robert Seerthaler, sans sécheresse ni distance. Au contraire. Il a le savoir-faire de l’artisan à son établi ; le geste précis, sûr, plein et beau.
Il est d’ailleurs reconnu pour cela dans le monde entier et primé ici ou là.
Son précédent roman, « Le dernier mouvement », s’attachait à la figure de Mahler, mais moins au compositeur célèbre qu’à l’homme resté attaché à sa cabane au fond du jardin, d’où il écoutait le merle lancer ses trilles.
Cette fois, c’est à un parfait inconnu que s’attache cet auteur. Ce qui l’intéresse, ce sont ces vies à peine vécues, marginales ou routinières, sans relief. Qu’est-ce qui fait une existence, sinon des petits faits, des épisodes dans un quotidien sans grande destinée. Comme ce rêve hors de portée, d’ouvrir un café, qui vous bouffera le temps et les économies, parce que chacun pourra venir s’y asseoir.
Et mine de rien, Robert Seethaler nous parle d’aujourd’hui, de cette gentrification en marche, un peu partout. De ces villes-vitrines où, « pour des types comme moi il n’y a plus de place nulle part », comme le dit une des personnes de ce roman. Ces personnes présentes dans ce roman sont des êtres à part entière en face desquels nous place Robert Seethaler, des gens chassés de leur vie par l’histoire, la guerre, et de leur quartier, par des spéculateurs ou des élus qui n’aiment la bière que dans des musées, pour des expériences sensorielles à 17 euros l’entrée, mais qui trouvent que le caberdouche du coin fait désordre, avec ses bougies entamées plantées dans un verre, avec son bastringue et sa chaleur humaine.