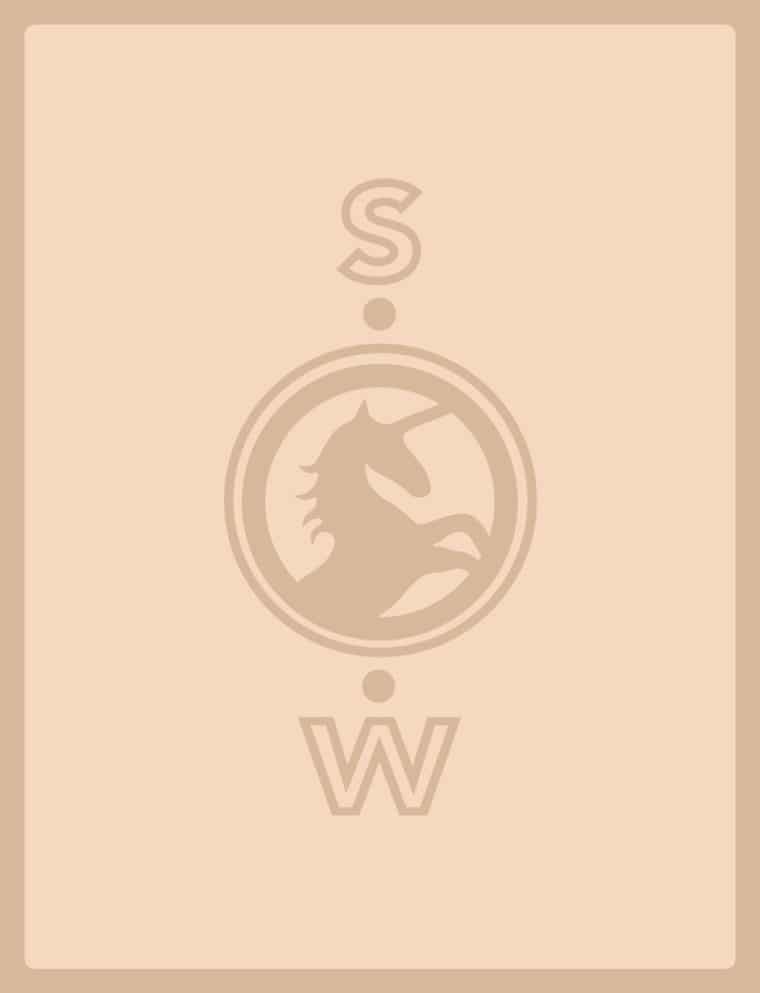
- Auteurs :
- Yanick LAHENS
- Louis-Philippe DALEMBERT
Yanick Lahens et Louis-Philippe Dalembert s’expriment sur la dette haïtienne et la question de la restitution
Article paru dans Le Monde :
« La dette imposée par la France à Haïti a, dès sa naissance, précipité le pays dans la ruine »
Un collectif d’intellectuels et d’écrivains haïtiens rappelle, dans une tribune au « Monde », que l’obligation faite à la jeune République d’Haïti, il y a tout juste deux siècles, de « dédommager les anciens colons », mérite réparation.
Le 8 juillet 1825, sous une pression qui se voulait diplomatique mais qui s’avéra militaire et coercitive, le gouvernement du président d’Haïti, Jean-Pierre Boyer céda aux exigences du roi de France Charles X. Celui-ci imposa une ordonnance datée du 17 avril 1825, stipulant qu’Haïti devait verser la somme colossale de 150 millions de francs or à l’Etat français, « destinée à dédommager les anciens colons » qui avaient pourtant maintenu pendant plus de deux siècles un système colonialiste, esclavagiste et raciste ayant contribué à la richesse de la France.
[…]
Lire l’article en entier sur le site du Monde.
Entretien de Yanick Lahens paru dans L’Histoire :
« Il n’y a pas de malédiction ! »
Pour la grande romancière haïtienne, très impliquée dans le développement social et culturel de son pays, Haïti est la matrice des relations Nord-Sud et du néocolonialisme, dont elle a subi, avant les autres, tous les avatars.
L’Histoire : Esclavage, catastrophes naturelles, violences et corruption… Comment réagissez-vous lorsque l’on évoque la « malédiction » d’Haïti ?
Yanick Lahens : Je refuse d’emblée de parler de malédiction. Un terme dangereux qui en dit long sur l’ignorance entretenue autour de ce pays. Ignorance propre à nourrir des stéréotypes têtus. Je parlerais plutôt de hasards qui ont tissé la trame de notre histoire. Un hasard climatique qui nous a placés sur la route des cyclones, un hasard géologique qui fait d’Haïti une terre traversée d’un réseau de failles. Un hasard géographique qui fait de nous l’« arrière-cour » des États- Unis. Mais le hasard qui compte le plus est de toute évidence celui de l’histoire. Voilà en effet un bout d’île qui a osé défier l’expansion de l’empire français, dont la puissance reposait sur le colonialisme, le racisme et le capitalisme de la dévoration. C’est ce hasard historique, vécu comme un « impensable » (Michel-Rolph Trouillot), une « anomalie », qui a biaisé beaucoup de lectures des événements survenus en Haïti et a nourri un narratif d’une cécité rassurante sur la fatalité et la malédiction.